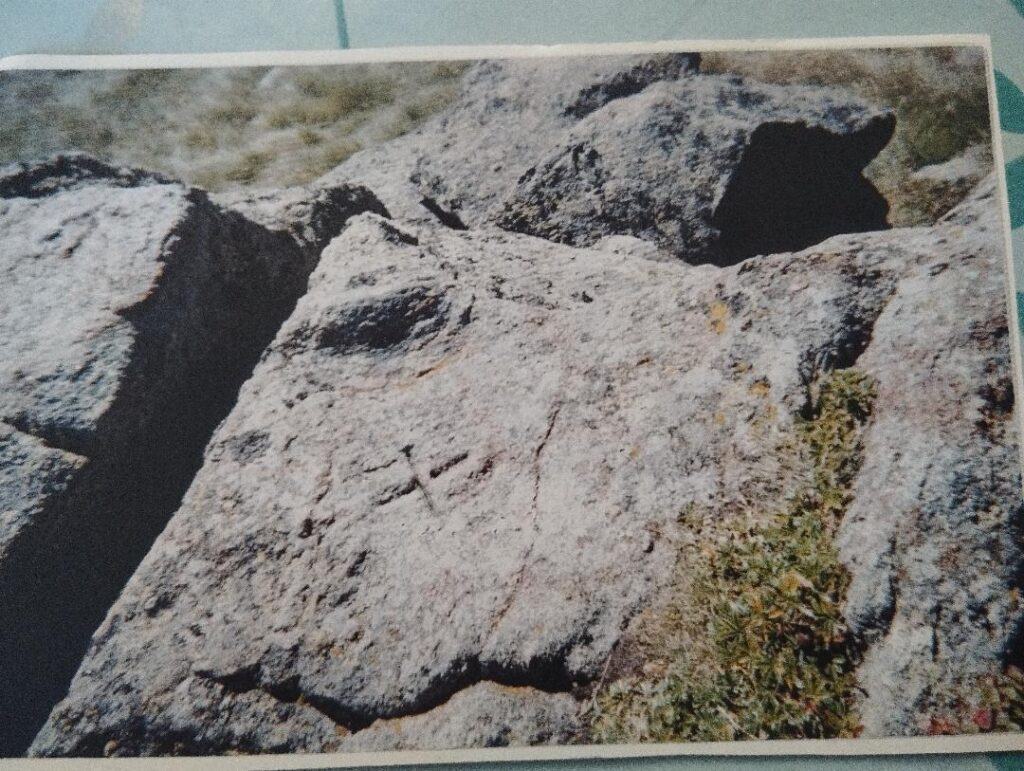En 1807 : les habitants de Rabat, excédés, organisent une incursion au Débes del Ressec et volent le bois coupé. Nouveau procès. Les gendarmes occupent Rabat durant quinze jours pour trouver les coupables qui ne seront pas identifiés et la commune sera condamnée à leur place.
En 1811 : les communes intentent une action auprès du tribunal de Foix pour faire cesser les coupes au Dèbes del Ressec. Bergasse déclare que ce quartier sera dorénavant mis en défens.
Mais 17 ans plus tard, en 1828, Bergasse recommence les coupes sur le même quartier toujours pour faire du charbon. Les maires de Rabat et Gourbit se rendent sur les lieux et font dresser procès-verbal par le garde champêtre. Le préfet saisi de l’affaire ordonne une enquête des Services des Forêts qui, pour la première fois, signale que les coupes pratiquées peuvent porter préjudice aux habitants alors que jusqu’ici les torts étaient du côté des usagers accusés de prendre le droit de tout faire. La plainte des communes est suivie d’un procès qui aboutit à l’arrêt de l’exploitation en attendant le résultat d’une expertise mandatée par le tribunal et réalisable avant 2 ans. Mais en 1830, l’expertise n’ayant pas eu lieu, Bergasse reprend les coupes de bois. De nouvelles protestations des communes et de nouveaux incidents s’ensuivent.
Tout ceci amène les communes de Gourbit et Rabat à contester la validité de l’acte d’achat de Bergasse. En effet, la loi qui autorisait la vente des biens nationaux précisait que la contenance des biens ainsi vendus devait être inférieure à 300 arpents soit 150 ha. Or les bois et montagnes de Rabat-Gourbit ont une superficie supérieure.
Les communes d’abord déboutées par un arrêté de la cour consulaire reviennent à la charge et obtiennent l’arpentage des forêts. Il est établi que la forêt contient plus de 300 arpents, pourtant la validité de l’acte est reconnue par les consuls.
Le propriétaire avait-il des appuis administratifs pour pouvoir acquérir puis conserver des biens en contradiction avec la loi en vigueur ?
Pour préserver leurs droits, les communes n’hésitent pas à engager des procès et à porter des réclamations auprès des administrations malgré tous les frais à charge que cela entraîne.
Dès 1805, pour mettre fin à ces conflits répétitifs, Bergasse demande au tribunal de contraindre les communes au cantonnement de leurs droits en vertu de 2 lois :
Une loi de 1790 qui autorise les propriétaires à exercer l’action en contournement contre ceux qui ont des droits d’usage sur leurs biens.
Une loi de 1792 qui donne à tout usager la possibilité de faire convertir ses droits en propriété.
Ainsi les usagers deviennent propriétaires d’une partie des biens de Bergasse et perdent les droits sur l’autre partie. Pendant de nombreuses années, cette question revient sur le tapis, mais sans aboutir. Ce n’est qu’en 1830 qu’un accord est signé. Rapidement, Bergasse en demande l’annulation sous prétexte que les maires ont signé sans habilitation de leur conseil municipal puisque aucune délibération les y autorisant n’a été produite. Les conseils municipaux sont réunis et donnent un accord postérieur à la signature des actes. Mais la transaction est annulée.
En 1834 : le tribunal reprend la mise en place du cantonnement. En rapport avec l’importance des droits anciens détenus par les habitants et la population des communes usagères, le tribunal attribue aux communes :
La moitié des bois en valeur.
Les deux tiers des pâturages qui devront former un tout de manière que leur usage n’apporte aucune gêne aux biens restant au propriétaire.
Le tribunal nomme trois experts pour établir l’évaluation basée sur leur position, leur contenance, la fertilité, le produit des bois. Ce jugement paraissait favorable aux communes ; pourtant Gourbit et Rabat firent appel avec autorisation du préfet auprès de la Cour Royale de Toulouse. Elles furent déboutées et le cantonnement fut mis en place en 1835 suivant les clauses du procès de 1834.
Rabat, Gourbit, Bédeilhac, Surba et Banat sont les communes devenues propriétaires. Elles doivent donner les droits d’usage aux autres communes : Génat, Lapège, Illier et Orus.
Les droits des communes propriétaires sont répartis selon les droits anciens et le nombre de feux allumants de chacune : Rabat 44,09 % – Gourbit 28,21 % – Bédeilhac 17,17 % – Surba 7,59 % – Banat 2,94 %.
Les communes ont mis plus de trente ans pour accepter et régler le processus du cantonnement. L’administration n’a pas fait trop d’opposition car la majeure partie des biens était en pâturages et non en bois.
L’ensemble de ces biens communs fut appelé « montagnes indivises ». Il s’étend sur 1 922 ha 60 a 20 ca dont 1 014 ha sur Gourbit.
En 1839,vont s’y ajouter 96 ha 56 a 25 ca de la Garrigue (ce quartier, propriété des seigneurs de Rabat, était devenu propriété de la commune de Rabat à la Révolution sans trop savoir pourquoi) transférées par la commune de Rabat aux montagnes indivises.
Les frais de cantonnement se sont élevés à 4 068,24 F et Gourbit a eu en charge 1 841 F. (Répartition faite suivant étendue des droits et feux allumants).
Une délibération du 9 mai 1840 fait état d’un vote de 400 F par le conseil municipal et les plus hauts imposés pour payer une partie de cette dette.
Ce cantonnement aurait dû amener le calme dans la vallée. Il n’en a rien été. Les habitants des communes continuent les vols de bois dans la propriété de Bergasse. Les communes sont rendues responsables des dégâts causés. Elles réagissent en prenant des arrêtés précisant que tout délinquant sera recherché et dénoncé.
À ces délits s’ajoutent ceux commis par les habitants des communes toujours usagères et en particulier ceux d’Orus qui, au début de chaque hiver entre 1843 et 1849, arrivent par bandes pour emporter bois et fagots dans le quartier de la Dosse sur la commune de Gourbit. Les gardes forestiers avertis des faits sont chassés à coup de pierres. Une plainte est déposée auprès du tribunal de Foix qui ordonne une enquête car les habitants d’Orus persistent à dire qu’ils ont le droit de prélever du bois sur la montagne de Gourbit. Ils seront déboutés en 1848. Ces incursions ont duré une dizaine d’années et furent parfois fois très violentes.
Joseph Véziau dans les carnets Ariégeois rapporte que « dans un affrontement, un homme de Gourbit coupa l’épaule d’un homme d’Orus d’un coup de hache ».
Les gardes forestiers surveillent délits et affrontements pour éviter qu’ils dégénèrent. Il est raconté qu’un homme de Gourbit qui avait eu maille à partir avec le garde forestier suivit ce dernier, l’attaqua et d’un coup de serpe lui trancha la gorge. Une enquête va suivre pour trouver le coupable.
La solidarité villageoise joue à plein lors des perquisitions, le coupable n’est pas dénoncé et, dit-on, les vêtements tachés de sang passent d’une maison à l’autre et restent introuvables.
Ainsi, pendant de nombreuses années, les biens de Bergasse mais aussi ceux des communes sont pillés. 1848 fut l’année des pillages les plus nombreux. Ils saccagent même une grange appartenant à Bergasse située à Embanels et qui est le refuge actuel.
Les dissensions entre les communes se multiplient surtout entre Rabat et Gourbit. En 1858, après l’incendie de Gourbit, les autres communes autorisent les habitants de Gourbit à prendre 100 sapins à la sapinière du Dèbes pour reconstruire les maisons. Mais quelques années plus tard, lorsque Rabat demande 15 sapins pour réparer l’horloge, Gourbit émet un refus qui fait réagir vivement le maire de Rabat. À son tour, la commune de Bédéilhac se verra refuser une demande de sapins par Rabat. Ces refus montrent bien que souvent Gourbit est en désaccord avec les autres communes.
Voici le texte de la délibération du 18 mars 1866 prise au Conseil Municipal de la commune de Gourbit : « M. le président a donné connaissance de la lettre de M. le préfet par laquelle il nous communique la demande formulée par la commune de Rabat des 15 sapins à prendre dans la sapinière indivise de Rabat, Gourbit, Bédeilhac.
Vu que ladite commune de Rabat s’est refusée à une semblable demande formée par la commune de Bédeilhac. Vu qu’elle semble ne s’appliquer qu’à mutiner incessamment les communes circonvoisines qu’elle voudrait gouverner despotiquement. Vu qu’il serait bon une fois pour toute de réprimer son orgueil et ses prétentions, de lui faire ressentir vivement ses torts, de l’engager par la suite à notre égard toute autre ligne de conduite et enfin de lui apprendre que nous ne sommes pas engagés dans ses biens, que nous avons notre amour-propre comme ils ont le leur et qu’on ne saurait point consentir à ce qu’ils s’offusquent impunément. Vu d’ailleurs que nous lui supposons des fonds de caisse, pour preuve l’achat des montagnes qu’elle voulait réaliser à elle seule. Après en avoir mûrement délibéré entre nous, repoussons la demande et répétons les même paroles qu’elle prononça lors de la demande de Bédeilhac. « Ils ont de l’argent, qu’ils achètent »…
Pour sortir de cette situation, Rabat demande au préfet l’autorisation de faire cesser l’indivision. La demande transmise par le préfet aux autres communes sera rejetée par Gourbit en invoquant la gêne pour les troupeaux et les désordres inévitables qui pourraient suivre.
Le préfet, après un rapport d’enquête des Eaux et Forêts, propose une division en deux lots ce qui ne gênerait ni la dépaissance, ni les coupes affouagères. Les communes ne sont pas d’accord.
En 1866 et 1867 : Rabat réitère sa demande et obtient l’autorisation de mettre l’affaire en justice : le tribunal nomme 3 experts qui remettront un rapport sur la valeur des parcelles. 6 ans plus tard, en 1873, Bédeilhac se range à côté de Rabat pour faire cesser l’indivision et un jugement intervient en1900 pour déclarer que l’expertise de 1873 étant incomplète, il faut nommé 3 nouveaux experts pour la reprendre.
Paulette et Juliette Laguerre