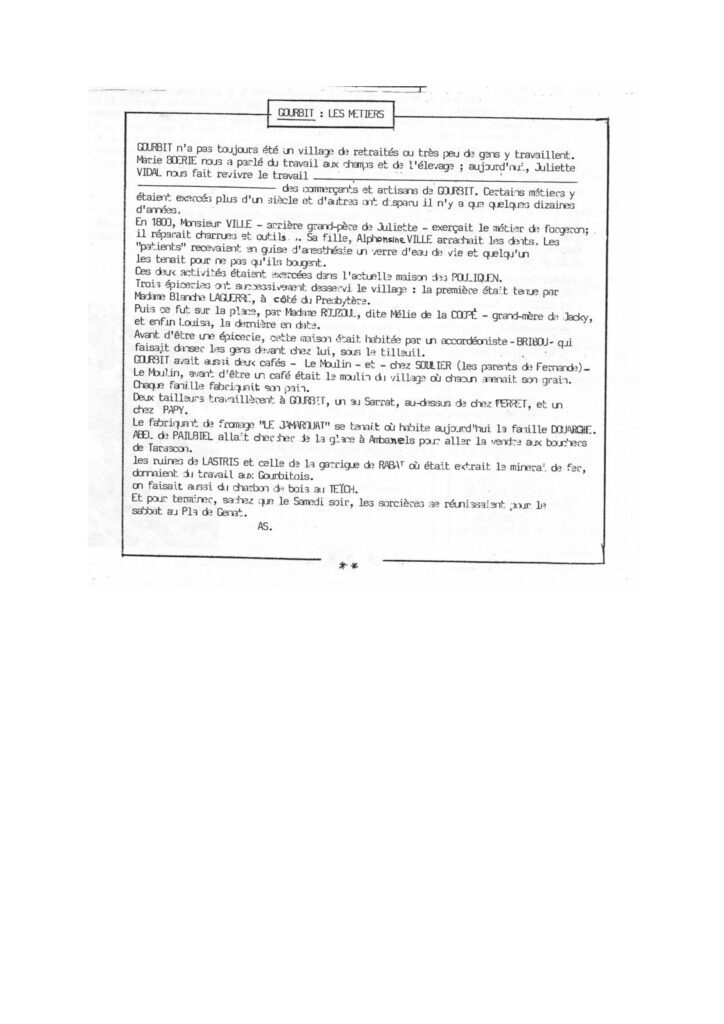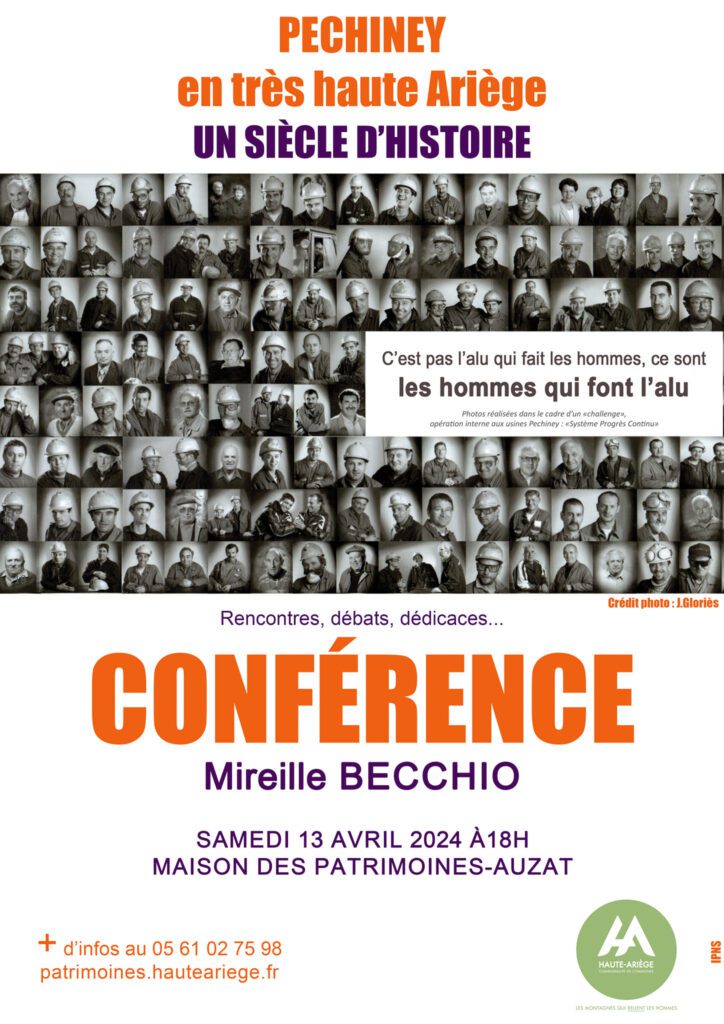Les territoires des montagnes de Gourbit et Rabat vont être soumis dorénavant à une double indivision sans autre équivalant dans les Pyrénées, parait-il.
Pour gérer ces biens indivis entre plusieurs communes, le préfet propose la mise en place de commissions syndicales autorisées par une loi de 1837. Cette commission, composée de délégués désignés parmi les conseillers municipaux des communes dont ils seront les porte-parole, est chargée de faire effectuer les travaux utiles à la gestion des biens, mais les ventes, échanges, partages ne sont pas de leur compétence et demeurent du ressort des conseils municipaux. Ainsi chaque vente de coupes de bois fait l’objet d’une délibération des conseils municipaux. Les membres seront renouvelés après chaque élection municipale, les délibérations de la commission approuvées par le préfet.
La première commission syndicale est créée en 1842 pour les montagnes, en 1869 pour la forêt indivise. La commune de Gourbit a 2 délégués par commission.
Les communes, à titres divers, sont devenues propriétaires dans l’indivision mais les litiges vont continuer malgré la nomination des commissions syndicales.
L’achat de la forêt indivise conclu, Bédéilhac demande le partage de ces biens. En 1872 puis en 1876, Rabat en fait de même alors qu’il avait refusé le partage de la montagne. Finalement, le rapport des experts étant défavorable à ce partage, il sera abandonné en 1912.
Après 60 ans d’oppositions, de luttes, de procès et de dépenses parfois lourdes, les conseils municipaux avaient enfin choisi la solution de la sagesse en gardant l’indivision de ces territoires qui pendant des siècles n’avaient formé qu’un tout.
Les communes devenues propriétaires doivent gérer au mieux de tous, la forêt d’une part, les montagnes de l’autre.
En 1789 : la révolution donna l’administration des bois aux communes. Leur gestion s’avère catastrophique et les bois et forêts seront de nouveau soumis au régime forestier. Le code forestier de 1827 fut appliqué à nos bois et montagnes dès 1837. En 1838, deux gardes forestiers furent nommés. L’un devait résider à Rabat (ce fut Estèbe Lizou) l’autre à Gourbit (ce fut Joseph Builles). Il n’y aura pas de guerre des demoiselles dans cette vallée. En 1854, les 34 ha de la sapinière du Dèbes Del Ressec furent exclus du régime forestier à la demande de l’administration forestière qui jugeait la parcelle trop dévastée. Mais devant les protestations des communes incapables de surveiller et de limiter les saccages, ces cantons furent remis sous le régime forestier en 1866.
La commune de Gourbit comme d’autres communes, dans le but de préserver les zones de dépaissance et le parcours des troupeaux, s’oppose à certaines soumissions au régime forestier ou au reboisement de certaines zones. Ainsi une délibération du 29 mai 1900 indique que le conseil municipal de Gourbit s’oppose à la soumission au régime forestier de 423 ha situés aux quartiers du Courtalviel, las Lesses, le Dèbes del Ressec, le bois de Cirié, Embanels, le Pla de Beulaygue, le Roc de Marty et le Cabal pour les raisons suivantes :
– La soumission « retiendrait » le parcours du bétail.
– Depuis 30 ans, la commune a accepté les repeuplements de la forêt pour en assurer son maintien.
– L’intérêt des habitants est la préservation de l’élevage.
– Le parcours a été déjà réduit puisque le quartier du Cabal a été pris en défens.
– Le reboisement n’a que peu d’intérêt pour freiner les avalanches qui sont courtes et ne créent que peu de dégâts dans une zone rocheuse et aride.
Par une délibération du 1er novembre 1867, la commune s’oppose à un semis prévu sur la Garrigue toujours pour préserver le parcours des troupeaux.
Paulette Laguerre & Juliette Laguerre